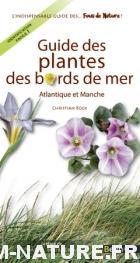Silène uniflore : de l’art mesuré d’agiter ses fleurs
Silene uniflora subsp. uniflora
On sait que de nombreuses plantes à fleurs disposent de tout un panel d’arguments leur permettant d’attirer des insectes pollinisateurs : la ou les couleurs, le nectar ou le pollen comme récompenses, l’émission d’odeurs attractives, la disposition des fleurs, l’imitation de femelles d’insectes, … Mais, auriez-vous pensé que les plantes soient capables d’attirer des pollinisateurs … par les mouvements de leurs fleurs provoqués par le vent ! Du genre : j’agite mon drapeau pour dire « coucou, je suis là ». Même comme naturaliste averti, j’avoue ne jamais avoir pensé à une telle possibilité ! Deux chercheurs gallois (1) l’ont fait et ont creusé la question en mettant en place un protocole d’une incroyable précision ! Ils ont choisi une espèce bien particulière et rare, le silène maritime. Pourquoi avoir choisi cette espèce ? Quel protocole ont t’ils mis en place et qu’ont t’ils démontré ?
Deux silènes maritimes
Le nom commun de silène maritime s’emploie en fait pour désigner deux sous-espèces d’une même espèce, le silène uniflore (bien mal nommé car ce n’est presque jamais le cas !) (Silene uniflora). Très proche du silène vulgaire (S. vulgaris) très répandu dans toutes sortes de milieux secs, il s’en distingue par ses pétales dotés d’écailles plus ou moins marquées à la gorge de la corolle (à la jonction entre la partie étalée ou limbe de chaque pétale et de l’onglet vertical qui le porte mais qui est caché dans le calice) et par un port couché en coussinets lâches. Tous les deux partagent le calice renflé en vessie qui persiste autour du fruit et leur vaut le nom populaire anglais de bladder campion (« compagnon à vessie »)
- Touffe de silène vulgaire, l’espèce la plus proche parente du silène maritime et très répandue
- Les fleurs ne possèdent pas d’écailles à la gorge de la corolle
- Le fruit, caché dans le calice persistant (déchiré ici) est une capsule sèche contenant les graines issues de la fécondation des ovules suite à la pollinisation
Le « vrai » silène maritime correspond à la sous-espèce type (S. uniflora subsp. uniflora) qui se rencontre sur le littoral de la Manche et de l’Atlantique plutôt dans la moitié nord et habite des milieux rocheux ou des pelouses arrosées par les embruns en haut des falaises ; c’est celui-ci qui a fait l’objet de l’étude citée. Il forme des coussinets lâches avec des tiges de 8 à 25cm de long, plus ou moins couchées, portant des fleurs blanches de 2 à 2,5cm de large et portées par groupes peu fournis.
- Touffe de silène maritime dans une paroi rocheuse en Bretagne ; c’est cette sous-espèce qui a été étudiée
Sur la moitié sud de notre littoral atlantique, entre Espagne et Vendée, vit une autre sous-espèce très proche (S. uniflora subsp. thorei), surnommée silène de Thore, qui vit, lui, dans les dunes et se distingue par ses feuilles plus larges et des fleurs par 1 à 3. Il est très proche du précédent et il existe des intermédiaires.
Nos illustrations (à une exception) présentent en fait la seconde sous-espèce mais pour autant cela ne signifie pas que les données scientifiques obtenues sur la première s’appliquent à celle-ci ; il faudrait vérifier !
- Touffe fleurie de silène de Thore dans les dunes de Vendée
- Les fleurs blanches sont groupées par 1 à 4
- Chaque fleur est portée sur un pédoncule qui la tient au-dessus de la plante
Un choix éclairé
La mobilité des fleurs (provoquée par le vent mais pas de leur fait) tient à leur position au bout d’un pédoncule floral plus ou moins long qui hisse la fleur ; il sert ensuite à tenir le fruit. C’est donc cet organe qui joue un rôle clé dans la capacité des fleurs à être agitées. On lui attribue classiquement un rôle soit dans la dispersion des graines quand il s’allonge après la floraison, exposant le fruit sec aux secousses du vent susceptibles de projeter les graines, soit dans la protection du pollen des fleurs contre la pluie quand il se courbe pendant la floraison comme chez les anémones pulsatilles (2) avant de se redresser ensuite.
- Chez l’asclépaide tubéreuse (plante ornementale) les fleurs sont portées par des pédoncules courts
- A maturité, la fleur fanée laisse place à un fruit alors que le pédoncule s’allonge et s’épaissit portant le fruit en hauteur.
- Touffe d’anémone pulsatille. Une très jeune fleur au premier plan est dressée ; ensuite, au cours de la floraison, le pédoncule se courbe et la fleur penchée vers le bas voit son pollen protégé de la pluie.
- La fleur fanée donne un groupe de fruits plumeux portés sur le pédoncule qui s’est redressé et allongé, facilitant la dispersion par le vent.
Dans la famille des Caryophyllacées à laquelle appartient le silène maritime, on connaît, notamment dans le genre Silene, des espèces à pédoncules très courts comme le silène acaule des hautes montagnes et des toundras arctiques et d’autres à pédoncules longs comme le silène maritime. On associait classiquement les pédoncules courts à la vie en haute altitude, sous la pression des vents violents sauf que le silène maritime vit lui aussi dans un milieu très exposé aux vents violents.
- Silène acaule dans une pelouse à 2200m d’altitude dans les Alpes
- Ce silène aux fleurs sur des pédoncules très courts vit dans des milieux très exposés aux vents violents
Alors pourquoi garde t’il des pédoncules longs alors qu’ils ne s’allongent pas après la floraison et ne semblent donc pas servir à la dispersion des graines et que çà pourrait gêner les insectes pollinisateurs lors de leurs visites en les secouant un peu trop ? De plus, il se caractérise par une très forte variabilité de ses pédoncules floraux plus ou moins longs et plus ou moins épais. Voilà donc les pistes très subtiles qui ont motivé le choix de cette espèce pour étudier cette question de l’impact éventuel de la mobilité des fleurs sur la réussite de la reproduction en attirant plus de pollinisateurs !
- Deux exemples de côtes rocheuses exposées aux vents ….
- … avec des pelouses rases en sommet de falaises
Un protocole à la hauteur
Une fois l’hypothèse posée, restent à inventer les expérimentations à mettre en place ! J’avoue rester toujours pantois devant la capacité des chercheurs à imaginer des dispositifs et à déployer une patience infinie pour les observations sur le terrain. C’est le cas ici avec un protocole incroyablement ingénieux que nous allons détailler histoire de saluer ce travail remarquable.
Pour tester l’héritabilité des caractères étudiés (longueur et épaisseur des pédoncules et mobilité des fleurs), des boutures de tiges de diverses longueurs ont été prélevées, mises en culture et l’année suivante, à partir de croisements contrôlés, la descendance a été suivie. Pour estimer la capacité à bouger des fleurs, on mesure le nombre d’oscillations par minute ainsi que l’ampleur de la plus grande oscillation subie pour chaque nouvelle fleur pendant 5 jours différents sous un vent modéré.
Sur le terrain (une côte galloise balayée par les vents), des fleurs fraiches prélevées sur des plantes sauvages sont fixées au bout de tiges en fil souple teint en vert de différentes longueurs (7,5 ; 15 ou 30 cm) et de deux épaisseurs (0,75 ou 2mm) puis installées au milieu de touffes naturelles dont on a au préalable supprimé toutes les fleurs. Les visites des insectes sont suivies par espèces, par durée de visite tout en mesurant les mouvements des fleurs visitées.
Pour évaluer l’impact sur la production de graines (et donc le succès reproductif), les chercheurs capturent des éristales, des visiteurs réguliers de ces fleurs, les placent dans des cages avec des plantes fleuries pour qu’elles se chargent de pollen puis les libèrent en plein air devant des touffes sauvages dont les fleurs ont été au préalable émasculées (étamines supprimées) et ensachées ; on laisse les mouches butiner une fleur donnée plus ou moins longtemps (10, 20, …… 90 secondes et plus) ; aussitôt après ce traitement, la fleur est ensachée et ses graines seront récoltées 3 semaines plus tard.
- Eristale (espèce indéterminée) sur des fleurs de menthe. Ces grosses mouches de la famille des Syrphidés sont des pollinisateurs efficaces.
Enfin, pour explorer l’impact de la mobilité des fleurs sauvages, ils gardent deux fleurs prêtes à s’ouvrir sur une touffe sauvage, enlèvent toutes les autres, mesurent les paramètres des pédoncules et après la floraison récoltent les graines produites !
Et je passe sur le traitement statistique des données, le croisement des expérimentations, etc …. Respect ! Je pense que je n’aurais jamais pu être chercheur !
Et alors, la mobilité, çà joue ?
Les caractères de longueur et d’épaisseur des pédoncules ainsi que la mobilité relative des fleurs induite semblent bien héréditaires même si cela reste à un niveau faible. La relation significative entre épaisseur de s pédoncules et leur longueur (un pédoncule long tend à être plus épais) indique que la sélection a du réduire la variabilité génétique dans la population étudiée.
Les tiges artificielles fines oscillent plus vite avec des mouvements plus amples. Les fleurs les plus agitées sur des tiges artificielles fines et longues sont visitées plus souvent mais moins longtemps par visite ; les fleurs sur des tiges moyennes en épaisseur et longueur sont celles dont les résultats se rapprochent le plus des observations sur les plantes sauvages. Cependant, la moindre durée des visites sur les fleurs mobiles se trouve compensée par le grand nombre de visites et l’attraction d’un plus grand nombre d’espèces.
La moindre durée des visites par fleur diminue les chances de pollinisation et réduit la production finale de graines viables. Le taux de fécondation des ovules atteint 95% pour des durées de pollinisation supérieures à 2 minutes et diminue sensiblement dès lors qu’on passe en dessous de la minute.
Au final, on observe donc que chez les fleurs « sauvages », l’efficacité de la pollinisation et donc le succès reproductif atteint son maximum pour des pédoncules de taille moyenne dont ni trop agités ni trop stables en cas de vent. Autrement dit, tout semble indiquer que la pression de sélection a conduit à un compromis (un trade-off) dans la croissance des pédoncules vers des fleurs susceptibles de s’agiter suffisamment pour attirer plus d’insectes de diverses espèces tout en évitant une mobilité extrême qui gêne les visiteurs et diminue l’efficacité de la pollinisation ! Des études récentes ont montré par ailleurs que les insectes possédaient bien des neurones sensibles aux mouvements ce que l’on contestait auparavant. Il va donc falloir désormais ajouter à la longue liste des dispositifs attractifs envers les insectes pollinisateurs la mobilité des fleurs dans le vent.
D’autres questions
Les chercheurs ne se contentent pas d’être ingénieux ; ils n’hésitent pas à critiquer leurs résultats et à les interroger sans cesse pour faire émerger de nouvelles hypothèses. Ainsi, ici, ils se demandent si la plante entière n’accentue pas la mobilité de ses jeunes fleurs de manière à attirer un maximum d’insectes les plus divers tandis qu’à l’échelle individuelle, chaque fleur au moment où elle deviendrait fécondable modifierait par exemple l’épaisseur de son pédoncule pour en diminuer la mobilité relative ; en termes de développement, c’est possible mais reste à démontrer
D’autre part, leurs expériences ont eu lieu avec une seule espèce d’insecte, une éristale qui était en fait la plus grosse des espèces visiteuses sur le site, choisie pour des raisons pratiques. Mais qu’en est-il des autres espèces plus petites, peut être plus agiles et plus aptes à supporter les balancements des fleurs dans le vent ? Il faudrait donc imaginer que la pression de sélection qui s’exerce sur les fleurs et leurs pédoncules varie selon les espèces pollinisatrices dominantes, lesquelles peuvent varier d’une population à une autre selon le climat, le milieu, …. Bref, on retombe sur un modèle dit régional où les mêmes causes ne produisent pas partout les mêmes effets !
BIBLIOGRAPHIE
- Do flowers wave to attract pollinators? A case study with Silene maritima. J. WARREN & P. JAMES. J. EVOL. BIOL. 21 (2008) 1024–1029
- WHY DOES THE FLOWER STALK OF PULSATILLA CERNUA (RANUNCULACEAE) BEND DURING ANTHESIS? SHUANG-QUAN HUANG,YOSHIT AKA TAKAHASHI, AMOTS DAFNI. American Journal of Botany 89(10): 1599–1603. 2002.