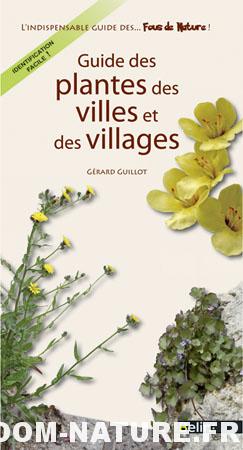La pierre est en nous !

Falaises calcaires (vallée de l’Ardèche) et leurs innombrables micromilieux favorables à la biodiversité (replats, fissures, aplombs, pitons, ….)
Dans les années 1980, Douglas Larson, chercheur canadien en botanique et en biologie de la conservation, met en place un groupe interdisciplinaire sur l’étude de l’écologie des falaises et milieux rocheux, milieu longtemps négligé ou considéré comme sans intérêt. En 1985, il entreprend l’étude des falaises de l’escarpement du Niagara, cette longue ligne de falaises qui borde les grands lacs américains au nord. Ce sera le début d’une série de découvertes et la naissance de l’écologie des falaises avec la prise de conscience que les grandes zones de falaises sont des hot-spots de biodiversité. En 1997, lors d’une année sabbatique, il visite de nombreux sites rocheux dans le monde et observe qu’il s’agit souvent de lieux ayant servi d’anciens refuges pour l’humanité. En même temps, il rapproche ses connaissances sur la flore et la faune de ces milieux rocheux avec une partie de la biodiversité urbaine liée aux bâtiments, aux murs, aux centres-villes. Ainsi va émerger au début des années 2000, l’Hypothèse des Falaises Urbaines (Cliff Urban Hypothesis) qui stipule que l’espèce humaine a recréé à travers ses constructions en dur, ses murs et ses cités, son habitat originel dans lequel elle avait évolué, les parois rocheuses et les grottes associées, et qu’une partie des espèces de ces milieux alors compagnes de l’homme l’ont suivi dans ses migrations et son installation dans les substituts en dur que sont maisons et bâtiments divers. Cette théorie ouvre un nouveau regard et de nouvelles perspectives sur l’écologie urbaine et la conservation de la biodiversité urbaine.
Les preuves par la flore
Des études statistiques montrent que nombre de plantes cultivées depuis longtemps dans les jardins (avant la mondialisation !), dans les potagers, comme plantes nourricières ou poussant dans les cultures comme « mauvaises herbes » proviennent en fait à l’origine d’environnements liés aux falaises et tout particulièrement des pentes d’éboulis ou des talus à la base des falaises ; ces sites sont enrichis en sels minéraux par l’érosion des falaises et alimentés en humidité par irrigation naturelle au goutte à goutte via les suintements depuis les falaises. Là, les plantes rencontrent des conditions moins extrêmes que sur les parois verticales qui leur procurent un certain abri et trouvent un sol meuble (même si il est caillouteux) dans lequel elles peuvent enfoncer leurs systèmes racinaires. Elles sont ainsi pré-adaptées à la colonisation dans toutes sortes de conditions. Cela ne signifie pas qu’il n’y ait que des plantes de falaises qui se soient acclimatées auprès de l’homme mais que cette catégorie naturelle fournit proportionnellement bien plus d’espèces que les autres catégories (par exemple les plantes forestières) tout comme le groupe des espèces de milieux ouverts (dunes, graviers et berges des cours d’eau). Un exemple frappant à cet égard est le chou cultivé (Brassica oleracea) domestiqué à partir d’une espèce sauvage des falaises côtières ; quand des choux échappés de jardin retournent à l’état sauvage, cela se passe toujours dans leurs habitats ancestraux de falaises y compris en dehors de leur aire originelle comme en Californie. Voir aussi l’exemple d’un légume oublié, le maceron (chronique) ou les fougères des murs (chronique).
L’autre aspect important à bien saisir c’est qu’une bonne partie de ces plantes sont devenues infiniment plus communes dans les habitats artificiels urbanisés que dans cet habitat d’origine, souvent difficile à cerner. Nous présentons ci-dessous quelques exemples illustrés parmi des espèces communes sachant qu’une autre chronique sera consacrée spécifiquement à la flore urbaine et à ses liens avec les falaises.
- Céraiste vulgaire (falaises ; zones sableuses dénudées ; pelouses de montagne)
- Piloselle officinale (falaises ; prairies tempérées)
- Pâturin comprimé (falaises ; rochers ; sables nus)
Un archétype : le biset
L’exemple de l’avifaune urbaine d’Europe occidentale qui nous est plus familière peut servir d’exemple pour illustrer cette grande proximité entre environnement urbain construit et les oiseaux associés à ces milieux minéraux et nichant dans les bâtiments.
La première espèce, qui ne vient pas à l’esprit d’un non-initié, c’est le pigeon biset des villes ; l’ancêtre sauvage de cet oiseau vit toujours au moins sur les côtes méditerranéennes et de la façade atlantique : c’est le pigeon biset des falaises côtières, très à l’aise au long des falaises verticales et qui niche souvent dans les entrées de grottes qui percent ces grandes parois. Ses capacités voilières s’avèrent très efficaces dans cet environnement d’à pics : brusque décollage grâce à de puissants muscles pectoraux (appréciés par les amateurs de pigeons à la cocotte !) ; ailes tenues relevées par rapport à l’horizontale (angle dièdre) d’où une meilleure stabilité ; très grande agilité des ailes.
Dans la chronique sur le biset des villes (voir cette chronique), nous avons par ailleurs signalé la découverte d’un lien étroit entre le pigeon biset des falaises et les hommes de Neandertal qui occupaient des grottes côtières vers le détroit de Gibraltar : ces derniers pratiquaient une récolte régulière de pigeons qui devaient nicher tout près d’eux. On sait par ailleurs que les pigeons biset ont par la suite suivi les hommes avec les premières implantations agricoles (dont certaines continuaient à s’installer près de sites de falaises comme abris) pour exploiter les céréales produites par l’homme. Cet exemple seul en dit déjà long sur ce lien homme/falaises/villes.
Oiseaux des villes
Mais la liste des oiseaux rupestres que l’on retrouve en ville ne s’arrête pas là et certains vous sont certainement familiers : le rouge-queue noir ou rossignol des murailles (voir la chronique) ultra présent en milieu urbain très construit et par ailleurs dans toutes sortes de milieux rocheux dont la montagne. Parmi les rapaces, l’exemple du faucon pèlerin reste très frappant : au cours des dernières décennies, ce rapace, hôte des falaises, s’est progressivement adapté au milieu urbain nichant au sommet des grands immeubles ou sur de grands édifices ; sa proie principale est ….le pigeon biset (ou l’étourneau sansonnet). Le faucon crécerelle, autre rapace rupestre niche aussi de plus en plus dans les édifices, voire sur les rebords de fenêtres dans des jardinières ! La famille des hirondelles compte plusieurs espèces très liées à l’environnement urbain ou humain : l’hirondelle rustique à la campagne dans les étables (on pense qu’elle aurait pu habiter originellement les entrées de grottes … où logeaient des hommes) ; l’hirondelle de fenêtre bien présente en ville et qui niche toujours sur des falaises en bord de mer ou en montagne ; l’hirondelle de rochers bien nommée qui s’installe dans les villages en moyenne montagne ; … Ajoutons à cette liste les choucas des tours, le merle bleu et le faucon crécerellette en milieu méditerranéen, les trois espèces de martinets (noir, à ventre blanc ou pâle) et, cerise sur le gâteau (pour sa beauté !), le tichodrome échelette, passereau strictement confiné aux hautes parois rocheuses montagnardes, qui vient passer l’hiver sur les grands monuments ou les ponts et aqueducs. En bord de mer, il faut désormais ajouter les nombreux goélands qui nichent sur les toits d’immeubles ou les mouettes tridactyles hôtes des bords de fenêtres dans le nord de l’Europe ; ces dernières nichent « normalement » dans les falaises abruptes et battues par les vents.
- Le choucas des tours niche en colonies dans les clochers, cheminées et grands bâtiments
- Les hirondelles de fenêtre installent leurs nids sous des avancées de toit
- Hirondelles de rocher nichant dans les villages de la haute vallée de l’Ardèche
- Goélands installés sur les toits et terrasses des villes portuaires
- Fientes indiquant le reposoir d’un faucon crécerelle dans la façade d’un lycée.
- En hiver, le tichodrome échelette descend en plaine et explore les falaises artificielles que sont les grands bâtiments. Photo J. Lombardy
En tout cas, comme pour la flore, on observe une très nette surreprésentation des oiseaux rupestres dans l’avifaune des centres-villes.
L’empreinte du rocher
Le corollaire de l’Hypothèse des Falaises Urbaines c’est que pour l’homme le milieu rocheux est un habitat modèle qu’il cherche à reconstituer de diverses manières dans ses constructions. L’architecture actuelle et passée en témoigne largement à travers les façades de béton et de verre des grands buildings, l’attachement à la pierre comme matériau de construction et valeur-refuge (un terme qui n’est pas banal !), les dallages et pavages au sol, les murs d’enceinte, l’importance des porches, des entrées, les ruelles étroites comme des canyons, … Sans oublier tous les édifices religieux ou symboliques, cathédrales, temples, arènes, cirques, mosquées, synagogues, … les citadelles et leurs remparts, les tours, … Bref, un monde de verticalité minérale percé d’ouvertures comme autant d’entrées de grottes dans des falaises.
- Flèches de la cathédrale de Clermont-Ferrand : la verticalité minérale érigée en symbole
- Immeuble moderne : de nouvelles falaises avec de nouveaux matériaux pas forcément favorables à la biodiversité
Mais cette attirance envers le rocheux s’exprime bien au delà et de manière universelle. Les grands sites rocheux (gorges, canyons, défilés, escarpements,…) exercent un pouvoir attractif considérable : le Grand Canyon du Colorado, les gorges du Verdon ou du Tarn, le Mont Rushemore, la Pain de sucre de Rio de Janeiro, … Une majorité de ces sites sont par ailleurs associés à une occupation humaine plus ou moins ancienne : Ayers Rock en Australie, les villages Asanazi dans le Colorado, les cercueils suspendus dans les falaises des Trois gorges en Chine, vieux de 3600 ans, …. On la retrouve encore dans nos sépultures : des tombeaux, des dalles de pierre massive, des caveaux aux parois bien épaisses …. Et que dire des menhirs, monolithes et autres dolmens qui parsèment une partie de l’Europe. Ils nous conduisent tout doucement vers la Préhistoire et ses abris sous roche et ses peintures rupestres qui nous sont bien familières et ceci nous amène à la question des origines de cette « falaisitude humaine ».
- Les timbres célèbrent nombre de paysages rocheux qui sont autant de sites fondateurs de l’humanité.
- Nos cimetières reflètent (encore pour l’instant !) notre penchant pour la pierre comme « refuge » même pour l’immatériel.
Back in Africa
Pour comprendre les racines de cette relation étroite homme/roche-falaises-grottes, il faut remonter aux origines des humains et du genre Homo. Il y a environ 1,5 millions d’années, une grande transition écologique est apparue dans le cadre d’évolution de la lignée des Hominidés : nous sommes passés de la forêt à la savane ouverte en lien avec une aridification croissante : un nouveau milieu plus ouvert avec quelques arbres dispersés sous un climat chaud en Afrique de l’Est ; un milieu certes riche en ressources variées animales et végétales mais relativement hostile envers des espèces aussi fragiles que les homonidés : une chaleur intense dans la journée et un soleil brûlant, un froid relatif la nuit (nous sommes sur des hauts plateaux), des charognards qui volent les proies chèrement abattues, et des prédateurs nombreux et bien « armés ». Dans ce contexte, nos lointains ancêtres ont du rapidement adopter des éléments du paysage susceptibles de leur apporter la protection contre ces dangers : les abris rocheux sous la forme de falaises et de grottes. Même les affleurements rocheux qui émergent du paysage, sans offrir d’abri, constituent des repères clés dans ces paysages monotones et offrent des points de vue permettant surveillance et anticipation et ouvrant des perspectives vers les horizons plus lointains.
- Reconstitution d’une scène du Néolithique dans un abri sous roche (parc des Bisons ; Ste Eulalie)
- Les falaises calcaires sont souvent percées de grottes et de cavernes qui procurent un abri sûr
Plus tard, les humains ont commencé à migrer hors de l’Afrique et à gagner des contrées plus nordiques avec un climat de plus en plus froid de type périglaciaire. Ils ont conservé cette association étroite avec grottes et falaises qui les ont d’ailleurs sans doute « sauvé » lors du dernier épisode glaciaire où, apparemment, la majeure partie de la petite humanité se trouvait concentrée sur les côtes avec l’océan et le littoral comme fournisseur de ressources. C’est là que nous retrouvons par exemple les hommes de Neandertal et les grottes de Gibraltar où, en plus, ils trouvent même des ressources spécifiques : les pigeons mais aussi toutes sortes d’oiseaux ou mammifères vivant dans les parois (dont des grands rapaces). La construction d’abris ne viendra que bien plus tard et encore l’habitat rocheux perdurera longtemps localement (habitat troglodyte par exemple).
Ainsi, sous la pression permanente de la sélection naturelle, notre relation et notre dépendance au milieu rocheux a du se tisser et être intégrée dans nos comportements jusque dans notre génome au point de continuer à ressurgir au quotidien jusqu’à nos jours.
Ca change quoi ?
Cette hypothèse, qui est loin d’être acceptée par toute la communauté scientifique, présente au moins un énorme avantage : celui de nous faire réfléchir sur le sens de notre environnement urbain que nous avons fabriqué au fil des millénaires. Les tenants de cette théorie inscrivent d’ailleurs l’espèce humaine parmi les espèces ingénieurs de l’écosystème, qui, par leur activité transforment leur environnement de manière à ce qu’il couvre leurs besoins vitaux, à la manière des castors américains qui par leurs barrages noient des vallées. Ceci conduit à nous réinclure dans la nature globale et à cesser cette césure homme/nature et cette vision entièrement négative du milieu urbain comme étant de la non-nature. Nous sommes une espèce naturelle à part entière avec son histoire évolutive et son habitat modèle.
- L’architecture humaine a bien su intégrer très harmonieusement ses édifices dans le paysage : quand la roche et la pierre ne font presque plus qu’un !
- L’Homme, quand il le veut bien (!), sait parfaitement réconcilier la nature et le bâti ! (Lagorce 07)
- Paysage rocheux artificiel mais en fait très naturel : non ? (Vogue 07)
L’hypothèse amène aussi à reconsidérer la biodiversité urbaine sous un autre angle : elle n’est pas composée que d’espèces invasives, ou banales mais elle renferme une proportion importante d’espèces issues du milieu rocheux (qui ne couvre que 1% de la surface terrestre !). A ce titre, les environnements urbains peuvent être considérés comme des refuges pour cette biodiversité comme en témoigne l’exemple du faucon pèlerin cité ci-dessus. On peut trouver des analogues naturels à chaque élément artificiel des villes ce qui permet de suggérer des pistes de gestion et de protection adaptées. Tout cela à condition que nous sachions aménager notre environnement et nos comportements de manière à le partager avec un maximum d’espèces !
- La nature peut reprendre ses droits même au coeur des grandes villes pourvu qu’on cesse de l’extirper !
- Les murs végétaux sont une des solutions pour réintroduire de la biodiversité dans les villes.
BIBLIOGRAPHIE
- The Urban Cliff Revolution: Origins and Evolution of Human Habitats. Douglas Larson, Uta Matthes, Peter E. Kelly, Jeremy Lundholm, John Gerrath. Fitzhenry and Whiteside. 2006
- Urban cliffs. J. Lundholm in The Routledge Hanbook of Urban Ecology. Ed. by I. Douglas et al. Routledge Handbooks. 2011
- Cliff ecology. D.W. Larson ; U .Maths ; P.E. Kelly. Cambridge University Press. 2000