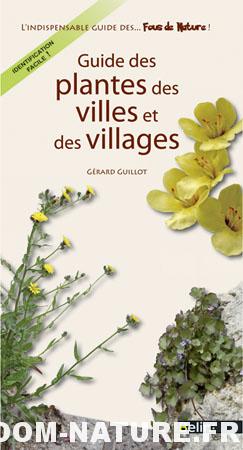Le pourpier sauvage : simplement exceptionnel (2)
Portulaca oleracea
Cette chronique sur le pourpier sauvage, une plante ultra-banale aux superpouvoirs, fait suite à une première partie consacrée à son écologie et son mode de vie et notamment sa reproduction. Dans cette seconde partie, nous allons explorer sa physiologie pour mieux comprendre comment il réussit à survivre dans des conditions extrêmes de chaleur, d’ensoleillement, de sécheresse et même de salinité ; finalement, la recherche de ses plus proches parents nous éclairera sur les origines de ces superpouvoirs.
Se nourrir ou périr ?
Face à la sécheresse, la majorité des plantes vertes se trouvent prises entre deux contraintes. Pour se nourrir, elles pratiquent la photosynthèse : avec l’eau et les sels minéraux prélevés dans le sol via les racines, les feuilles grâce à la chlorophylle, pigment vert contenu dans les chloroplastes, fabriquent des sucres et des protéines en utilisant la lumière comme source énergétique et en prélevant du dioxyde de carbone (CO2) dans l’air comme source de carbone. Pour ce faire, elles doivent donc prélever ce gaz dans l’air par de microscopiques orifices à ouverture modulable, les stomates. Mais ces mêmes orifices servent aussi à évacuer la vapeur d’eau (évapotranspiration) ce qui permet la circulation montante de la sève. Toute plante verte qui se retrouve dans des conditions de fort éclairement et de sécheresse potentielle se trouve donc confrontée à un dilemme : garder ses stomates ouverts pour prélever du CO2 et exploiter la lumière pour se nourrir mais en perdant de l’eau et en risquant d’atteindre un point de rupture fatal ! Alors comment font les plantes telles que le pourpier vivant dans des conditions extrêmes de chaleur, lumière et sécheresse ?
Des modalités différentes de la photosynthèse peuvent permettre dans une certaine mesure de résoudre ce problème. La majorité des plantes vertes (85%) pratiquent la photosynthèse dite en C3 : les réactions impliquées se font de jour et dans une seul type de cellule des feuilles ; le CO2 capturé est d’abord converti en une molécule à 3 atomes de carbone (C3) grâce à une enzyme clé surnommée Rubisco ; cette machinerie fonctionne de manière optimale pour des températures de l’ordre de 25°C et son rendement reste moyen car elle est « parasitée » par un autre processus concomitant, la photorespiration. On pressent d’emblée qu’un tel mécanisme fonctionnant de jour avec des stomates ouverts ne va pas permettre la survie en milieu très chaud et sec. Effectivement, au cours de l’évolution, d’autres modalités sont apparues par des subtiles modifications de ce processus de base de la photosynthèse.
De nombreuses plantes des milieux désertiques chauds (telles que les cactacées ou les crassulacées) ont développé une autre photosynthèse dite CAM (10% des espèces de plantes) : la nuit, pour un optimum de 15°C, ces plantes ouvrent leurs stomates et prélèvent le CO2 qu’elles stockent dans leurs tissus ; le jour, elles ferment leurs stomates ce qui évite les pertes fatales en eau et convertissent le CO2 prélevé de nuit en molécules alimentaires avec un optimum de fonctionnement autour de 35°C. Or, chez le pourpier, sous des conditions habituelles, les stomates restent ouverts de jour comme de nuit et on ne met pas en évidence ce type de photosynthèse CAM. Cependant, en cas de très forte sécheresse, un processus proche de celui-ci peut se mettre en place. Mais le reste du temps, le pourpier fonctionne selon un troisième mode encore différent très peu répandu (5% des plantes vertes) : la photosynthèse en C4 !
La stratégie C4
Cette autre photosynthèse a évolué de manière convergente et indépendante dans plus de soixante lignées de plantes vertes : elle se caractérise par mode de transformation différent du CO2 qui est d’abord fixé sous forme de molécules d’acides à 4 atomes de carbone (C4) dans un type particulier de cellules, les cellules M du tissu chlorophyllien de la feuille ; dans un second temps, ces molécules passent vers d’autres cellules groupées en une gaine entourant les vaisseaux conducteurs de sève : là, le CO2 fixé est relibéré et converti par l’enzyme classique Rubisco. Ainsi, ces plantes ont une anatomie des feuilles bien reconnaissable avec ces gaines autour des vaisseaux (anatomie de Krantz). Ce dispositif en deux étapes améliore nettement le rendement tout en éliminant la photorespiration et son optimum se situe autour de 35°C. Ainsi, les plantes en C4 se retrouvent presque insensibles aux fortes chaleurs au niveau de leur capacité de photosynthèse, soit un avantage décisif !
Pour autant, cette évolution s’avère encore plus compliquée car au sein de la famille des pourpiers (Portulacacées), on reconnaît parmi la centaine d’espèces deux sous types de photosynthèse en C4 et même une espèce qui présente un stade intermédiaire original entre C3 et C4. Ceci indique une évolution réitérée de manière indépendante avec un résultat final quasi identique mais en fait différent dans ses mécanismes intimes ! D’autre part, les tiges conservent une capacité photosynthétique au niveau de leur cuticule mais avec selon processus en … C3 ! Il se pourrait même qu’il y ait un couplage entre la photosynthèse exceptionnelle en CAM (voir ci dessus) et celle des tiges en C3 ! Je ne sais si vous suivez toujours mais tout ceci indique une incroyable versatilité des pourpiers avec trois systèmes de photosynthèse différents qui cohabitent dans la même plante.
Super économe
En tant que xérophyte, plante adaptée à des environnements chauds et très secs, le pourpier a de quoi dérouter : il garde les stomates (voir ci-dessus) de ses feuilles ouvert de jour (ce qui lui permet donc de poursuivre la photosynthèse). Encore plus surprenant, il possède une densité plus forte de stomates sur la face supérieure exposée à la lumière que sur la face inférieure tournée vers le sol, alors que la majorité de xérophytes n’ont pas de stomates sur la face supérieure ! A priori, on pense à une démarche suicidaire, les stomates étant autant de points de perte en vapeur d’eau par évapotranspiration. Ce serait en fait un moyen d’éviter une transpiration excessive du fait du port prostré avec la face inférieure en contact avec le sol qui emmagasine la chaleur ! Mais, outre l’option photosynthèse en C4 évoquée ci-dessus, le pourpier dispose de plusieurs dispositifs favorables : les stomates sont plutôt petits ce qui limite les pertes ; la cuticule des feuilles (la « peau ») est assez épaisse ; il possède surtout d’importantes réserves d’eau stockées dans les tiges et les feuilles très charnues : le tissu des feuilles est presque dépourvu de chlorophylle et dédié à cette fonction ; le rapport surface/masse reste assez faible grâce à des feuilles de taille modeste. Surtout, le pourpier est équipé d’un système racinaire très performant : son étalement autour de la plante peut atteindre un rayon de 1,50m et donc capter la moindre pluie ; la racine pivotante principale importante est doublée de nombreuses racines secondaires fibreuses. Enfin, en cas de sécheresse extrême, le pourpier peut perdre ses feuilles et survivre ainsi jusqu’au retour de la pluie et réacquérir alors de nouvelles feuilles, le tout dans le cadre de son cycle court d’annuelle d’été !
Nous avons vu (voir le chapitre Espèce multiple de la partie 1) que le pourpier présentait de nombreuses « formes » ou microespèces différentes et ce d’autant qu’il a une répartition mondiale. On a donc cherché à tester la résistance à la sécheresse de ces différentes populations à partir d’échantillons de graines prélevées dans des banques internationales : on constate de très fortes variations d’une région à l’autre et aussi selon les stades testés (germination, plantule, adulte). A cette occasion, on a détecté une population remarquablement résistante (nommée Tokombiya), originaire de l’ouest de l’Erythrée, une région avec une moyenne annuelle de 200m de pluie par an et des températures moyennes annuelles au-dessus de 30°C : sa résistance ne s’exprime qu’au stade adulte. Le stress hydrique serait perçu par le système racinaire étendu dont l’architecture se transformerait alors pour faire face en quelques jours.
Coup de chaud
Teneur en eau et chaleur se combinent le plus souvent selon des modalités variables en fonction des environnements. Dans le cas particulier des cultures maraîchères (voir la partie 1) où le pourpier prolifère, il y est confronté à la fois de la chaleur et à une forte humidité du fait de l’irrigation continue. Les études montrent qu’alors il conserve un pouvoir élevé de photosynthèse tout en limitant les dégâts internes liés à l’oxydation. Ainsi, on observe une moindre concentration de composés oxygénés comparativement avec des plantes sensibles à la chaleur ; par contre, la plante accumule des protéines anti choc de chaleur et diminue le taux d’une hormone (acide abscissique ABA) ce qui améliore le fonctionnement des stomates permettant ainsi à la photosynthèse de tourner à plein régime. Ceci explique le pouvoir ultra invasif du pourpier dans ces cultures où il tend à tapisser les inter-rangs.
Par contre, dans une majorité d’environnements naturels, la sécheresse se combine avec de fortes chaleurs. On a pu montrer que l’association chaleur/sécheresse causait plus de problèmes pour le pourpier que chacun de ces stress isolés. Dans de telles situations, il active plusieurs voies métaboliques qui lui permettent de se protéger comme la fabrication d’antioxydants, de substances protectrices contre la diminution de la teneur en eau des cellules et de réparateurs de cellules. Ainsi, le pourpier confirme ses immenses pouvoirs de moduler son métabolisme dans les directions les plus variées tout en affichant des caractères anatomiques déconcertants pour une plante de milieux secs et chauds (voir paragraphe précédent).
Remédiateur
Depuis longtemps, notamment dans les cultures irriguées des pays semi arides confrontées au problème de la salinisation progressive des sols, on avait observé que, non content d’être résistant à la sécheresse, le pourpier supportait des salinités moyennes des sols. Des expériences avec des cultures sur des sols avec une salinité croissante montrent que cela n’affecte pas le contenu en eau des feuilles alors que le contenu en sucres et en minéraux augmente ; de manière inhabituelle dans un tel contexte, on observe aussi une hausse des lipides dans les feuilles pour les salinités intermédiaires. Le prélèvement de certains minéraux tels que le sodium et le chlore augmente avec la salinité croissante mais aussi le zinc. Seules des salinités élevées affectent la production de biomasse chez cette plante. Le taux de germination des graines diminue sensiblement avec la salinité croissante.
Tout ceci montre que même s’il n’est pas une plante strictement halophyte (capable de vivre sur des sols très salés) le pourpier résiste bien aux accumulations de sels minéraux ce qui a suscité des expérimentations pour l’utiliser en phytoremédiation, i.e. pour éliminer des minéraux accumulés en excès dans des sols pollués. Une première application concerne justement les sols irrigués progressivement salinisés, un problème qui affecte 30% des terres cultivées dans le monde. Des expériences ont été menées en Ouzbékistan montrent des cultures de pourpiers prélèvent de l’ordre de 500 kg de sels /ha ce qui correspond à 17% des quantités de sels accumulées dans les dix premiers centimètres du sol. L’intérêt c’est que cette pratique de « désalinisation » ne requiert pas d’irrigation et qu’en plus on peut récolter la plante comme légume à consommer ! En Inde, on a testé des systèmes d’irrigation expérimentaux avec des effluents industriels riches en métaux lourds avec deux espèces pourpiers dont le pourpier sauvage que nous connaissons : les résultats semblent concluants avec des prélèvements significatifs sur au moins trois des métaux lourds : zinc, cadmium et arsenic.
Parentés
Après avoir parcouru toutes ces originalités du pourpier, on est amené à se poser la question des origines de celles-ci : de qui tient-il ces superpouvoirs ? Pour répondre à cette question, il faut zoomer en mode négatif ou grand-angle pour remonter l’arbre du vivant depuis sa famille et découvrir ses plus proches parents successifs.

Pourpier à grandes fleurs très cultivé comme ornementale 
Fleur en gros plan (cultivar)
Le genre pourpier (Portulaca) avec sa centaine d’espèces représente désormais le seul genre de la petite famille des Portulacacées. La définition de celle-ci a considérablement changé depuis 2010, date à laquelle des études génétiques ont littéralement explosé l’ancienne famille qui comportait plusieurs lignées distinctes et ne répondait donc pas au cahier des charges de la classification moderne du vivant dans laquelle une famille équivaut à une lignée. Ainsi, on a extrait de cette ancienne famille mal délimitée plusieurs nouvelles familles dont les Basellacées avec l’épinard de Malabar une plante exotique cultivée ou les Montiacées avec plusieurs genres présents dans notre flore comme les Montia, les Claytonia (introduits) ou connus comme plantes horticoles tels que les Lewisia ou les Calandrinia. La nouvelle famille des Portulacacées se distingue par au moins trois critères uniques : des fleurs regroupées en inflorescences contractées, des fruits operculés qui s’ouvrent comme une boîte (pyxide : voir partie 1) et l’anatomie interne particulière (liée à la photosynthèse en C4 : voir ci-dessus) des feuilles.

Montia minor des terrains dénudés humides 
Lewisia cotyledon des USA cultivée en rocaille 
Claytonia perfoliata, introduite et naturalisée 
Epinard de Malabar (Basella rubra), plante comestible 
Calandrinia, belle ornementale
Déjà, parmi les familles ainsi séparées, on note des plantes plus ou moins succulentes comme les Lewisia ou la claytonie perfoliée parfois cultivée comme légume vert. Mais surtout, dès que l’on remonte l’arbre de parentés, on trouve comme plus proches parents la très curieuse famille des Didiéracées regroupant des arbres et arbustes succulents de Madagascar et les célébrissimes Cactacées (voir la chronique). Donc, comme on dit pour les humains à la campagne, « le pourpier a de qui tenir ! ». Pourtant, on ne détecte guère de points communs entre cactus et pourpiers à part la succulence … à quelques petits détails près que seul l’œil exercé des botanistes taxonomistes peut détecter ! A la base des feuilles des pourpiers, à un fort grossissement, on observe des faisceaux de soies : on a longtemps pensé qu’il s’agissait des vestiges de stipules (petites feuilles à la base des pétioles). En fait, elles correspondent à des pousses courtes très condensées à l’aisselle des feuilles équivalentes (homologues) des aréoles des cactus dont les feuilles sont transformées en épines (voir la chronique sur les épines des cactées) !

Alluadia de la famille des Didiéracées 
Cactus avec les aréoles porteuses d’épines 
Touffes de soies homologues des aréoles à la base des feuilles du pourpier
Par ailleurs, quand on poursuit la remontée de l’arbre de parentés au sein du grand ordre des Caryophyllales où se placent les portulacacées, on trouve plus en amont (donc moins proche parente) une grande famille de plantes succulentes très développée en Afrique du sud : les aizoacées avec des genres bien connus comme ornementales tels que les figues des Hottentots (Carpobrotus) devenus invasifs sur les côtés ou les Delosperma et bien d’autres. On peut aussi citer les amarantacées avec une légion de genres adaptés aux terrains salés (plantes halophytes) telles que les soudes ou les salicornes. Les pourpiers s’insèrent donc bien dans une grande lignée (Caryophyllales) dans laquelle à plusieurs reprises, de manière indépendante, des lignées ont évolué vers la succulence.

Salicorne arbustive (Amarantacées) 
Plante caillou (Lithops) : Aizoacées 
Delosperma cooperii : Aizoacée ornementale 
Carpobrotus edulis ou Figue des hottentots : introduit et naturalisé, invasif
Bibliographie
THE BIOLOGY OF CANADIAN WEEDS. 40. Portulaca oleraceaL. K. MIYANISHI ; P. B. CAVERS. Can. J. Plant Sci.60: 953-963 ( 1980)
Comparative Proteomic Analysis of the Thermotolerant Plant Portulaca oleracea Acclimation to Combined High Temperature and Humidity Stress.YunqiangYang et al. 2012 American Chemical Society
Physiological and Metabolic Changes of Purslane (Portulaca oleraceaL.) in Response to Drought, Heat, and Combined Stresses.Rui Jin et al. Frontiers in Plant Science January 2016 | Volume 6 | Article 1123
Drought tolerance and AFLP-based genetic diversity in purslane (Portulaca oleraceaL.).Shuxin Ren et al. Journal of Biotech Research ; 2011; 3:51-61
EVOLUTION OF LEAF ANATOMY AND PHOTOSYNTHETIC PATHWAYS IN PORTULACACEAE. GILBERTO OCAMPO et al. American Journal of Botany 100(12): 000–000. 2013.
Revealing diversity in structural and biochemical forms of C4 photosynthesis and a C3–C4 intermediate in genus Portulaca L. (Portulacaceae). Elena V. Voznesenskaya et al. Journal of Experimental Botany, Vol. 61, No. 13, pp. 3647–3662, 2010
Effects of salt stress on purslane (Portulaca oleracea) nutrition. M. Teixeira & I.S. Carvalho Ann Appl Biol 154 (2009) 77–86 ; 2008
Environmentally Useful Technique – Portulaca Oleracea Golden Purslane as a Salt Removal Species. A. HAMIDOV et al. WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT Issue 7, Volume 3, July 2007