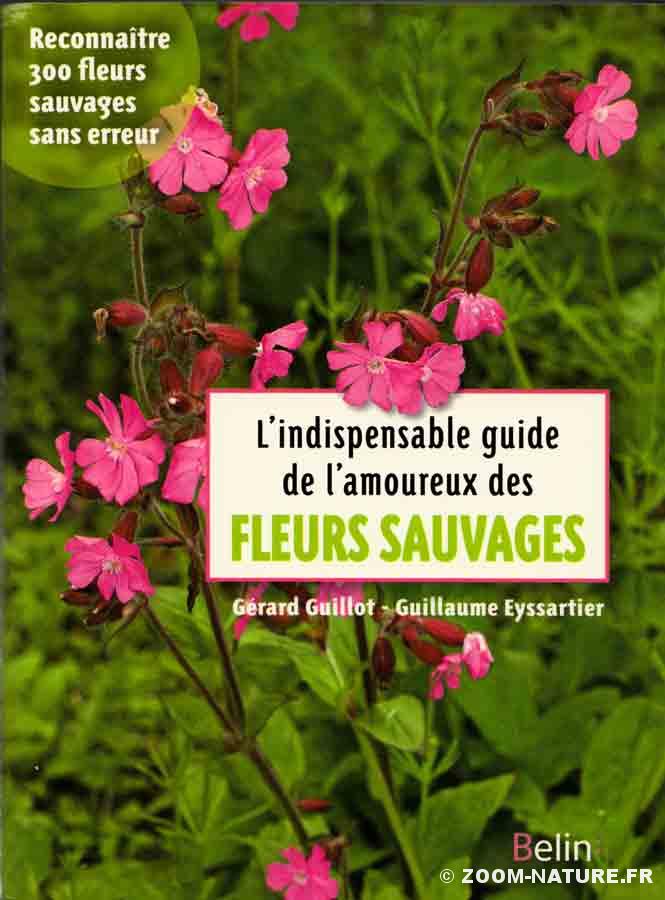Le côté obscur de l’orchis bouc
Himantoglossum hircinum
Certains lecteurs se demandent peut être ce qui motive le choix des sujets (très disparates !) de ces chroniques ; très souvent, le point de départ reste anecdotique : un détail ou d’une question qui m’accrochent au passage ! Ainsi, cette chronique est née d’une observation très fortuite : deux pieds d’orchis bouc arrachés sur un tas de déblais issus d’un terrassement. Je les ai rapportés à la maison pour les observer de plus près et j’ai enfin pu voir de mes yeux les fameux tubercules que je n’avais jamais, par principe, déterrés dans la nature. Je les ai transplantés après la séance photo dans mon jardin mais avec peu de chances de succès car ces plantes supportent très mal les transferts. Cette observation a donc servi de point de départ à des recherches sur cette espèce spectaculaire (la plus grande de nos orchidées). La chronique va explorer la partie souterraine de son cycle de vie, celle qu’on ne voit pas … sauf rencontre imprévue !
Rosettes des pelouses

Une superbe colonie d’orchis bouc : une image désormais bien plus répandue qu’il y a encore une vingtaine d’années.
Au cours des dernières décennies, l’Orchis bouc a connu une expansion fulgurante tant en taille des populations qu’en répartition géographique : cette espèce, longtemps confinée dans des sites semi-naturels du type pelouses calcaires, a commencé à coloniser des sites herbeux plus ou moins perturbés par les activités humaines : accotements et talus des routes, anciennes carrières, terrains de golf, pelouses des jardins. Ainsi, nombre de particuliers possèdent, souvent sans le savoir, des orchis bouc dans leur carré de gazon. Sans le savoir car si on ne sait pas reconnaître les rosettes de feuilles, la tondeuse à gazon les taillera comme le reste et la belle ne fleurira jamais tout en persistant grâce à ses organes souterrains. Une fois fleurie, on ne peut la confondre avec aucune autre plante à fleur ni autre espèce d’orchidée : un long épi échevelé, très fourni en fleurs verdâtres rayées de pourpre, chacune avec un très long labelle (l’un des trois pétales transformé) de 3 à 6cm de long torsadé en hélice sauf la pointe.
- Deux milieux traditionnels de l’orchis bouc : les pelouses arides (ici sur basalte et dominées par la germandrée petit-chêne)
- Les hautes pelouses herbeuses à brome dressé ont longtemps été le milieu d’élection de cette orchidée
- Deux « nouveaux » milieux : une pelouse près d’une maison pas trop entretenue (dans le sens positif pour la biodiversité !)
- Même dans les pelouses très entretenues, l’orchis bouc s’installe jusqu’au coeur des villes.
Comment reconnaître l’orchis bouc au stade végétatif (1) ? Comme une bonne partie de nos orchidées, elle forme des rosettes de feuilles qui font penser à celles des jacinthes par leur consistance un peu charnue et leurs nervures parallèles. Cette rosette, posée sur le sol et plus ou moins étalée, se compose de plusieurs feuilles (de 1 à 6 en général) non opposées de grande taille : 6 à 15 (voire 25) cm de long sur 3 à 5cm de large ; ovales, avec des bords un peu repliés, elles se démarquent par leur nervation marquée et leur teinte vert foncé grisâtre. Autre critère-clé : ces rosettes apparaissent en début d’automne (septembre octobre) et ne manquent pas alors d’intriguer.
- Rosette fournie au coeur de l’hiver : noter la couleur vert foncé grisâtre et l’aspect charnu
- A partir d’avril, chez les pieds qui vont fleurir, la future tige monte accompagnée de nouvelles feuilles dressées.
- Vue de dessus, on constate l’emboîtement en spirale des feuilles successives qui composent une rosette
- L’orchis bouc fleuri ne peut être confondu ! Noter les feuilles qui commencent à jaunir alors que celles de la rosette ont quasiment déjà disparu
- Epi floral très fourni et d’aspect échevelé
- Chaque fleur porte un long labelle torsadé qui émerge sous un « casque » verdâtre : impossible à confondre !
Belle occasion donc, si vous en trouvez dans votre pelouse, de les marquer individuellement avec un bâton : ainsi, au printemps suivant, lors des tontes (le moins souvent possible pour la biodiversité !), vous l’éviterez et vous aurez la joie, peut-être, de la voir fleurir.
- Au Lycée de Cournon d’Auvergne, en 2010, dans le cadre d’un projet environnemental, une classe de Seconde de S. Dief, professeur de SVT a étudié et protégé des orchis bouc (et d’autres espèces) présents dans les pelouses du Lycée
- Un marquage avec des fils et des piquets a permis d’éviter la tonte des orchidées qui ainsi pu fleurir en compagnie d’orchis pyramidaux.
Cycle décalé
Au cœur de l’été, les rosettes ont toutes séché sur pied après avoir bruni ou noirci. Les jeunes plantes sèchent en premier parfois dès le début du printemps (périodes sèches), puis les plantes de taille moyenne et enfin les « adultes ». Pour les pieds qui fleurissent, les feuilles commencent parfois à sécher dès le début de la floraison. En août, il ne reste donc plus rien au-dessus du sol sauf, pour les pieds ayant fleuri, des tiges sèches dressées fructifiées. A partir de la fin août ou début septembre ou plus tard s’il y a un épisode de sécheresse automnale, les rosettes apparaissent et vont se développer jusqu’à l’entrée de l’hiver. Caractère singulier pour une espèce au tempérament méditerranéen qui atteint désormais l’Europe centrale jusqu’en Autriche et qui expose donc ainsi ses feuilles charnues aux rigueurs de l’hiver !
- Une rosette est apparue (novembre) au pied de cette tige sèche, seul reste de la floraison de l’été passé
- Rosette avec sa tige florale de l’an passé : noter que celle-ci se trouve légèrement décalée sur le côté (voir le paragraphe sur le tubercule)
L’élaboration d’une telle rosette est rendue possible par la présence sous terre d’organes souterrains chargés de réserves nutritives, des tubercules accompagnés de racines. Le gros avantage d’un tel cycle en apparence décalé, c’est que la rosette sera prête à entrer en action dès le début du printemps, voire plus tôt dans les régions méditerranéennes, i.e. à élaborer de nouvelles réserves nutritives via la photosynthèse ; celles-ci vont servir à recharger ou renouveler les tubercules pour l’année suivante et, éventuellement, à élaborer la tige et son inflorescence géante et à fructifier et produire des graines. Sans cette avance, la plante aurait sans doute du mal à boucler son cycle avant l’été et ses températures nécessaires pour assurer la maturation des fruits et des graines. Elle permet aussi à la plante d’exploiter les pluies automnales qui marquent le climat méridional.
Un an sous terre
Des botanistes anglais (2) ont suivi pendant un an, en laboratoire, un pied adulte transplanté au mois de juin avec un dispositif permettant d’observer les organes souterrains. En juin, la plante présente un seul tubercule sans racines adjacentes. A la mi-août, alors qu’à l’extérieur les feuilles ont disparu, un bourgeon de pousse de feuilles apparaît au sommet du tubercule. Mi septembre des racines se forment au sommet du tubercule ; les feuilles s’allongent, enroulées les unes dans les autres en cornet, et pointent à la surface. En octobre -novembre, la rosette se déplie et commence à s’étaler tandis que sous terre les racines s’allongent et forment comme une couronne qui s’enfonce autour du tubercule.
En mars de l’année suivante, les pointes de feuilles montrent déjà des signes de flétrissement en brunissant. Une second tubercule se forme à l’aisselle du précédent, plus allongé et plus clair : les réserves fabriquées par les nouvelles feuilles ont permis son élaboration. En avril, les deux tubercules ont grossi et sont bien pleins : le second se développe encore plus ; un troisième latéral apparaît de l’autre côté. Fin mai, à deux semaines de la floraison, le tubercule central, celui de l’année précédente, commence à se vider et à se ratatiner : ses réserves alimentent une tige porteuse de la future inflorescence encore en boutons ; les feuilles brunissent de plus en plus et les racines commencent à se nécroser. En juillet, le « second » tubercule est devenu prépondérant et sera le seul à survivre à l’été : c’est lui qui produira les feuilles et les racines de l’automne suivant.
- Six photos prises début mai sur deux pieds trouvés arrachés (voir introduction) : les tubercules et les racines en couronne
- Gros plan sur le tubercule central brun flanqué du second, blanc, en cours de formation
- Racines blanches un peu charnues qui partent de la base de la tige
- A la base de ce gros pied, un second pied s’est installé probablement issu d’une germination d’une graine
- Tubercules du second pied nettement plus petit
- Le tubercule brun s’est vidé et a nourri la rosette de feuilles ; la relève est prête avec le second blanc et chargé de réserves.
Ainsi, s’effectue une sorte de turn-over des tubercules qui se relaient : ceci explique notamment la tendance très légère de la plante à se déplacer de quelques millimètres chaque année vu que le second tubercule apparaît sur le côté du premier. D’autre part, la formation d’un troisième tubercule, qui n’est pas systématique, traduit la capacité de multiplication végétative : il pourra donner naissance à un second pied, collé au pied mère. Cependant, dans la nature, on trouve souvent de tels pieds « emboîtés » mais sans savoir s’ils résultent de ce processus ou de germination indépendante d’un jeune pied juste à la base de la plante fructifiée.
- Deux pieds prêts à fleurir ; noter les feuilles qui accompagnent les tiges.
Poussière de graines
Le tubercule est donc la pièce maîtresse du cycle de l’orchis bouc. Mais comment se forme t’il au départ ? Il nous faut remonter au tout début de l’histoire : aux graines. Après la floraison, si elle a réussi, la plante fane et le long épi floral devient une tige sèche où l’ovaire de chaque fleur fécondée a cédé place à une capsule, un fruit sec ovale allongé qui va au cours de l’automne se déchirer progressivement et laisser s’échapper une pluie de graines microscopiques : le poids moyen de l’une d’elles est de 0,05 … millionième de gramme ! Chaque capsule peut en contenir plus de mille (mais le nombre varie beaucoup) et un bel épi peut produire jusqu’à cinquante capsules. Il y a donc de la réserve !
- Après la floraison, les fleurs fécondées fanent : la corolle sèche tandis que l’ovaire vert se gonfle
- L’ovaire se redresse et les ovules à l’intérieur se transforment en graines minuscules ; il devient une capsule qui va sécher.
On pense que vu leur légèreté extrême, elles sont facilement entraînées par le vent. Il est évidemment très difficile de suivre les déplacements de graines aussi minuscules ; des modélisations montrent que la majorité d’entre elles atterrissent en fait dans un rayon de … un mètre autour de la plante mère ! Effectivement, sur le terrain, on observe souvent des nuées de jeunes plantes autour d’un pied adulte, jusque sous les feuilles des rosettes. Cependant, il doit bien se produire des transports à longue voire très longue distance lors de coups de vent violent.
- Autour de quelques plantes adultes, on voit une nuée de jeunes plants sans doute issus de la germination des graines de l’un des pieds qui a fleuri.
- Certaines colonies regroupent des dizaines d’individus plus ou moins rapprochés.
Dans le cas de l’orchis bouc et dans le cadre de son expansion récente dans des milieux anthropisés, l’homme pourrait être un autre vecteur de dispersion. Ainsi en Angleterre où l’espèce a beaucoup progressé, de nouvelles populations sont apparues loin les unes des autres, sans véritable continuité. Sur 19 populations connues, six se trouvent sur des terrains de golf ! Deux hypothèses peuvent alors être avancées : ou les terrains de golf représentent des pistes d’atterrissage idéales vu leur surface ouverte pour des graines transportées par le vent ; ou bien, plus probablement, les joueurs de golf transportent ces graines d’un terrain à l’autre sur leur matériel ou leurs vêtements.
Sur le fil du rasoir
On pourrait se dire qu’avec autant de graines produites, il n’y a pas de souci pour ces plantes et leur avenir. C’est sans compter avec la modalité ultra particulière de la germination (3 et 4). Déjà, leur extrême légèreté, avantage a priori pour la dispersion, se paie au prix fort : pratiquement pas de réserves nutritives comme dans une graine classique et un embryon (le « germe ») réduit à presque rien. Arrivées au sol, avec leur enveloppe ou tégument très mince, nombre d’entre elles vont être victimes de microorganismes au premier rang desquels des champignons du sol. Et pourtant, contradiction ultime, la graine va avoir besoin d’entrer en interaction nutritive avec les filaments (mycélium) d’une espèce de champignon très précise pour pouvoir réussir à développer son embryon sans réserves. Ce passage obligé se retrouve chez toutes les orchidées.
Si la graine n’entre pas en contact avec ce champignon, elle ne pourra pas se développer. Une fois le contact établi, le champignon introduit ses filaments dans la graine et la colonise dans sa partie centrale formant des pelotons internes. Si l’interaction réussit (voir ci-dessous), les échanges nutritifs permettent à l’embryon de la graine de se développer. Les cellules de la graine digèrent progressivement les pelotons de mycélium ce qui permet la croissance de l’embryon. Il se forme alors un organe transitoire appelé protocorme envahi par le champignon. Cette première étape peut prendre déjà à elle seule trois ans ! Lentement, un premier tubercule se forme au sommet du protocorme très réduit au départ (3mm). Le champignon envahit ce nouvel organe puis les premières racines qui se forment.
Je t’aime moi non plus
Présenté ainsi, tout paraît merveilleux. En fait, cette interaction n’a, semble t’il rien de pacifique. La graine possède des moyens de défense chimiques contre les invasions des champignons qui, rappelons le, sont des ennemis jurés des graines dans leur grande majorité. Si la reconnaissance du champignon « ami » ne se fait pas, il sera rejeté et la graine mourra ; il peut aussi pénétrer et surmonter les barrières défensives et « dévorer » la graine. La mise en place de cette interaction se fait donc dans un cadre conflictuel permanent et seule la mise en place d’un équilibre précaire aboutit à un résultat positif pour l’orchidée.
Après l’émergence de la plantule, cette relation va d’ailleurs évoluer. Chez la majorité des orchidées chlorophylliennes, le champignon initial va être rejeté voire digéré et éliminé quand la plante est devenue indépendante. Une seconde interaction avec un nouveau partenaire peut alors se mettre en place entre d’autres champignons (dont des espèces bien connues telles que morilles, truffes, pézizes, …) et seulement une partie des racines autour des tubercules. Dans le cas de l’orchis bouc, je n’ai pas réussi à trouver d’informations sur cet aspect : une nouvelle interaction avec un ou des champignons s’installe t’elle au niveau des racines ? En tout cas, son tubercule fabrique comme chez les autres orchidées des substances antibiotiques appelées phytoalexines (dont une appelée hircinol qui dérive de son nom latin) qui combattent les champignons ! Ceci signifie que les tubercules sont exempts de tout champignon et que l’infection, si elle existe se cantonne aux racines.
On comprend ainsi mieux pourquoi les orchidées sauvages ne se cultivent pas ou si mal hors de leurs milieux naturels (autrement dit, pas besoin de chercher à en arracher pour les transplanter !) : elles ont besoin au début au moins de la présence dans le sol de leur champignon compagnon avec lequel elles ont coévolué depuis très longtemps. Les environnements contaminés par des pesticides dont des fongicides (anti-champignons) ont donc peu de chances d’héberger des orchidées sauvages terrestres.
BIBLIOGRAPHIE
- Proposition d’une clé de détermination à l’état végétatif des genres d’orchidées de la France métropolitaine. S. Lesné. Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest-nouvelle Série- tome 42- 2011
- Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel. P. D. CAREY and L. FARRELL. BIOLOGICAL FLORA OF THE BRITISH ISLES. List Br. Vasc. Pl. (1958) no. 641, 1
- Texte extrait de la conférence présentée aux 25e Journées Mycologiques d’Entrevaux (2008) par M-A. Sélosse sur le site http://orchidees-alsace.hautetfort.com/la-mycorhize.html
- Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg. Société Française d’Orchidophilie. M. Bournérias. Parthénope Ed. 1998