Nommer les non-humains : l’art humain de dominer le vivant
16/11/2022 Avec l’avènement du langage, l’Homme a naturellement mis des noms sur les éléments de son environnement dont les autres êtres vivants, les non-humains. Toutes les populations humaines ont ainsi mis en place une nomenclature de noms d’espèces ou de groupes qu’ils côtoyaient dans leur environnement quotidien. Mais, à partir notamment du 15ème siècle, les européens ont entrepris d’élargir leur domaine en allant à la recherche de nouveaux territoires lointains qu’ils se sont empressés de s’approprier selon un processus bien connu de colonisation, sans aucunement prendre en compte les populations indigènes déjà installées depuis très longtemps. A cette occasion, on a évidemment aussi découvert une foule de nouvelles espèces animales et végétales dont certaines extraordinaires, dans le sens où elles étaient très différentes de ce dont nous avions l’habitude. Le processus de prise de pouvoir des terres « découvertes » (sous-entendus par nous-mêmes) s’est tout autant reporté, avec encore plus de violence et d’intensité, sur ces non-humains. Parmi les processus sournois d’appropriation et de domination alors mis en place, figure l’attribution de noms aux « nouvelles » espèces rencontrées. L’anthropocentrisme et l’eurocentrisme ont alors (et continuent actuellement) largement guidé le choix des noms attribués ; en fait, dans la majorité des cas, il ne s’agissait même pas de nommer mais de (re)nommer les espèces sur lesquelles les populations indigènes avaient depuis longtemps posé leurs noms. Sans le savoir, nous perpétuons cette pratique en utilisant ces noms et en croyant en toute bonne foi qu’ils sont « les » noms véritables des non-humains ainsi désignés. A travers quelques exemples iconiques, nous allons essayer de détricoter ce processus et d’en explorer les racines et les conséquences.
La métaphore de San Salvador
Dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492, après une longue traversée d’au moins neuf semaines, les trois navires affrétés par C. Colomb abordent une île (peut-être une des Bahamas actuelles), la première terre rencontrée depuis leur départ. C. Colomb s’empresse de la nommer San Salvador (St Sauveur en français) pour remercier Dieu de lui avoir permis cette traversée et la monarchie espagnole catholique qui a financé cette expédition. En la nommant, il en prenait aussi possession au nom de cette monarchie. Pourtant, comme il le relatera plus tard dans ses écrits, lui et ses hommes avaient rencontré sur cette île des indigènes qui, eux, nommaient leur terre Guanahani. Donc, en toute connaissance de cause, C. Colomb s’est donné le droit de (re)nommer cette île pour assoir son pouvoir et sa domination.
Les européens poursuivront ainsi inlassablement cette pratique consistant à (re)nommer les nouveaux pays et peuples « découverts » au fur et à mesure des explorations et expéditions lointaines. Celle-ci n’est bien sûr qu’une des diverses pratiques mises en œuvre pour assoir le pouvoir et la domination occidentale ; bien qu’en apparence « anodine » par rapport aux actions « physiques » directes, elle n’en possède pas moins une puissance d’action redoutable et déstructurante pour les peuples indigènes. Ce pouvoir octroyé devenait un élément de l’ordre naturel et donné par Dieu : il ne restait plus qu’à évangéliser les peuples colonisés pour qu’ils l’acceptent eux aussi comme « dans l’ordre des choses ».
Cette pratique de (re)nommer s’est appliquée méthodiquement, de la même manière, aux non-Humains afin d’en prendre aussi possession et de les exploiter ou souvent de les massacrer à volonté.
Acte politique
Nommer une chose, un lieu, une personne, un non-humain constitue un acte premier et le plus basique de la pratique du langage ; c’est ce qui nous permet ensuite d’en parler (ou d’écrire) de manière spécifique. Cet outil langagier est d’une puissance remarquable et nous a permis, nous humains, de décupler nos capacités d’adaptation en transmettant bien plus rapidement et efficacement de nouvelles informations captées. En ce sens, le langage est un moyen de pouvoir et nommer se trouve au cœur de ce super pouvoir. Quand on nomme un être vivant, que ce soit un individu ou une espèce, on choisit un nom en fonction de la représentation que l’on s’en fait mais aussi en fonction de comment les autres le perçoivent. Chaque nom porte donc avec lui un « fardeau » de représentations qui vont ensuite modifier la perception que l’on va se faire de l’être nommé. Or, les premiers explorateurs des 15 et 16ème siècles ont souvent rapporté des descriptions fictives, imaginées ou déformées à propos des nouveaux êtres vivants découverts mais en les présentant comme des réalités tangibles : éléphants et serpents géants par exemple, êtres marins délirants, … et les indigènes rencontrés n’y échappent pas. Tout ceci a contribué à répandre l’idée de mondes non civilisés (sous-entendus par rapport au nôtre) qu’il convenait rapidement de ramener dans le giron de la vraie civilisation, la civilisation occidentale.
De ce fait, aucun nom n’est neutre et porte sa charge de représentations liées à son histoire et au contexte dans lequel il est apparu et a été retenu. Or, nous allons voir que nombre de non-humains ont été nommés en fonction non pas de ce qu’ils étaient vraiment (forme, couleurs, modes de vie, lieux de vie, … réels et non fantasmés) mais en fonction du ressenti d’hommes qui les considèrent comme des « choses » extérieures (la fameuse séparation entre nature et culture selon P. Descola), ne partageant guère avec nous que le fait d’être vivants, et en fonction de la civilisation européenne et de son environnement naturel considérés comme la seule référence qui vaille.
Une très vieille habitude
Cette manière de s’approprier les non-humains en les nommant de manière orientée s’enracine très profondément dans l’histoire de l’Europe et de la religion chrétienne dominante. La lecture du livre 2 de la Genèse est plus qu’éloquente à ce sujet quand l’homme premier (Adam) se voit octroyer par Dieu le pouvoir de nommer les animaux qu’il venait de créer :
« L’Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l’homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l’homme lui aurait donné́. L’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs ; mais, pour l’homme, il ne trouva pas d’aide qui fût son vis-à-vis. » (Genèse 2 :19-20).
Ainsi, on voit la séparation très nette entre l’homme et les animaux : l’homme (Adam), doué de langage et du savoir sur ce qu’il voit, se voit donner le pouvoir (avant l’apparition de la femme, Eve, bien entendu) du premier acte de contrôle en définissant les êtres nommés. Tout se passe comme si, avant cela, les animaux n’avaient pas d’identité, n’existaient pas en l’absence de l’homme ; c’est l’homme qui les révèle via son pouvoir sans limites. Ainsi s’est forgée cette domination très inégale dans nos relations envers les autres espèces vivantes et cette inégalité majeure a été ensuite considérée comme donnée et méritée, allant de soi, preuve de la grand sagesse humaine.
L’intervention d’Adam dans la Genèse 2 avait été préparée en amont dans la Genèse 1 :
« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. »
Ces lignes résonnent très curieusement en cette année 2022 où la population humaine vient de franchir le seuil des 8 milliards d’individus … Même les végétaux n’ont pas été oubliés :
« Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence : ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. »
La rhétorique de la domination et de l’assujettissement est là dans toute sa crudité : le grand malentendu avec le reste du vivant y apparaît en creux.
Fausses ressemblances
Celui qui nomme, (des européens pendant plusieurs siècles), reflète sa vision du monde plutôt que de décrire celui qui est nommé. Ainsi, quand les européens ont voulu nommer de nouveaux animaux découverts hors d’Europe dans les nouveaux territoires explorés, ils l’ont souvent fait en référence à ce qui existait en Europe de diverses manières.
La plus courante a consisté à introduire dans le nom de l’animal nouveau celui d’un animal européen, de préférence un animal domestique, ce qui au passage justifiait souvent le fait qu’on puisse le tuer et le consommer (voir le dernier paragraphe). Deux exemples édifiants illustrent bien cette pratique : l’hippopotame et le cochon d’Inde.
Hippopotame a été fabriqué de toutes pièces par les européens à partir de deux mots grecs : hippos(cheval) et potamos (rivière), soit le cheval de la rivière … Un cheval ? Ce n’est pas vraiment à cet animal qu’il ressemble et c’est pourtant ce nom qui a été retenu ; avec l’usage, on tend à oublier l’étymologie et beaucoup de gens sont persuadés que c’est « le » nom international de cet animal. Pour info, en langage zoulou, l’hippopotame se dit izumvulu ; en langue sotho, on le nomme kubu ce qui signifie rebelle, sans doute pour son caractère ou pour son « hésitation » à vivre entre l’eau et la terre.
Le cas du cochon d’Inde est encore plus sidérant : ce petit rongeur originaire des Andes d’Amérique du sud n’est ni un cochon auquel il ne ressemble en rien, ni ne vient d’Inde ; simplement, on nommait souvent « d’Inde » ce qui venait de loin (voir aussi l’exemple du marronnier). Les anglais n’ont pas fait mieux avec Guinea pig ni les Suédois ou les Allemands avec des noms signifiant « cochon de la mer » ; seuls les espagnols s’en sont approché au mieux avec un nom signifiant « petit lapin des Indes ». Dans ces deux exemples, on voit bien la double trace de l’eurocentrisme (en Inde, loin d’Europe) et de l’anthropocentrisme (réduire à un animal domestique proche).
Orang-outang
Une autre pratique a consisté à utiliser des noms indigènes mais en les latinisant et en changeant souvent au passage leur prononciation : on apprenait ensuite aux indigènes comme il fallait écrire « correctement » les noms de ces animaux. L’exemple le plus frappant à cet égard est celui du grand primate indonésien très connu, l’orang-outang. Ce nom est composé de deux noms malais orang pour homme et outang ou utanpour forêt, soit « homme de la forêt » ou homme sauvage. Or, il semble bien (il y a débat selon les linguistes) que ce nom malais n’ait jamais été utilisé pour désigner directement ces grands singes mais s’appliquait à des peuples de la presqu’île de Malacca où vivait aussi l’orang-outan.
En tout cas, dans une étude très fouillée conduite auprès de l’ethnie Iban qui peuple les forêts secondaires où survit la seule population restante d’orang-outang de la partie malaise de Bornéo (Sarawak), J. Rubis démontre que ce peuple nomme ces grands singes par le nom de maias et en distinguent quatre « sortes ». Ils n’emploient pas le mot orang-outang pour le désigner. Le choix de ce nom par les européens explorateurs relève selon elle de la vision colonialiste de « l’harmonie mythique du sauvage ». A travers une longue enquête ethnographique auprès de ces populations indigènes, cette chercheuse montre comment le fait d’avoir ainsi renommé les maias en orang-outang induit des tensions et des incompréhensions autour des stratégies de conservation pilotées par des ONG occidentales. La prise en compte de la culture des Ibans et de leurs inter-relations avec la forêt et les maias ne se fait que de manière très partielle : ainsi, même actuellement, sous couvert de « bonnes intentions », on continue de nier ces liens homme/non-humains et on perpétue la « malédiction des noms usurpés ».
Célébration humaine
La manière la plus répandue peut-être de s’approprier des espèces a consisté à les nommer à partir de nom de scientifiques ou de célébrités en lien avec les découvreurs. Cette pratique a été particulièrement développée en botanique. Déjà utilisée dans l’antiquité, elle fut remise « à la mode » à la fin du 16ème siècle par le botaniste C. Plumier qui a beaucoup exploré « les Indes orientales » ; elle fut ensuite largement reprise par Linné qui en usa beaucoup (ainsi que de la mythologie de l’antiquité purement occidentale) pour composer les noms de genres de sa nomenclature binomiale. C. Plumier nomma ainsi Fuchsia triphylla, une plante trouvée à St Domingue et nommée molla ecantu (plante de beauté) par les indigènes ; ce nom honorait la mémoire de L. Fuchs (1501-1566), célèbre médecin et botaniste bavarois. C. Plumier en créa ainsi bien autres : Begonia d’après le nom de l’un de ses mécènes, M. Begon, gouverneur de St Domingue ; Sloanea d’après H. Sloane ; Suriana d’après un collègue décédé Surian, Lobelia pour le botaniste Lobel, Bromelia, Bauhinia, … Souvent, il connaissait les noms indigènes de ces plantes mais ne les a pas retenus : ainsi il nomma Ximenia americana un petit arbre épineux en l’honneur d’un collègue religieux, Ximenes, et du navigateur Amerigo Vespucci ; pourtant il savait que cet arbuste était nommé macaby (« poisson épineux », allusion à son aspect) par les indigènes Taino locaux.
De toute évidence, un tel nom ne nous dit rien sur la plante elle-même et en plus ledit botaniste n’avait même jamais vu cette plante. On traite la plante comme un objet qui permet de « faire de la communication » car tous ces hommages flattaient souvent les destinataires pour ceux qui étaient contemporains et permettaient de faciliter ses recherches et voyages. En retour, d’autres botanistes ont immortalisé son nom (en Occident en tout cas) en l’intégrant dans des noms d’espèces comme la laitue de Plumier (voir la chronique) ou le nom de genre des frangipaniers (Plumiera). Parfois, on aboutit même à ce que les deux éléments du nom latin (genre/espèce) soient tous deux des noms de botanistes comme par exemple le Fuchsia de Magellan (qui a bien sûr un nom local, chilco).
Préférer le nom d’une personne (que l’histoire a souvent par ailleurs depuis largement oublié) au lieu de se focaliser sur des traits réels des plantes change leur perception ; cela induit l’idée qu’elles « appartiennent » à des européens alors que depuis des millénaires des ethnies indigènes les connaissaient, s’en servaient éventuellement et étaient en interelation étroite avec elles. Cette pratique a touché aussi les noms des animaux et les exemples sont légion : gazelle de Thompson, zèbre de Grévy, …
Nous parlons jusqu’ici au passé comme s’il s’agissait de pratiques abandonnées. Or, il n’en est rien. Un exemple récent édifiant illustre tristement la poursuite de cette appropriation inique du vivant. En 2019, des arachnologistes européens décrivent une nouvelle espèce de tarentule au Sarawak (voir ci-dessus) grande comme une main et remarquable par la coloration bleu fluo de ses pattes ; ils créent un nouveau genre compte tenu de ses originalités et la nomment Birupes simoroxigorum. L’épithète d’espèce a été construit à partir des prénoms des trois enfants des collecteurs de cette araignée : Simon, Roxanne, et Igor. Difficile de faire plus « néocolonial » comme nom et en plus avec une sombre histoire de biopiratage car l’espèce a été capturée et exportée illégalement …pour ensuite être élevée et commercialisée. On ne peut trouver meilleur exemple de la chosification des non-humains : des objets commercialisables permettant en plus de faire du buzz sur les réseaux sociaux.
Permis de tuer
Tout le monde connaît l’adage : qui veut tuer son chien l’accuse de la rage. Cette tactique sournoise a largement été utilisée via la création de catégories auxquelles on assignait un certain nombre d’espèces. Cet étiquetage change complètement le traitement réservé aux espèces concernées. Ainsi selon que vous classez telle espèce parmi les nuisibles causant des dégâts aux cultures, comme gibier à la chair délicieuse ou comme animal de compagnie, elle connaîtra des sorts bien différents. Etiqueter ou catégoriser donne le pouvoir de faire entrer les non-humains dans le cadre d’usages ou d’activités très différents en oubliant le coté souvent arbitraire de cette catégorisation ; l’étiquette dédouane l’usager qui se sent légitime d’intervenir. Ainsi au début du 20ème siècle, au Kenya, un Institut de régulation encadré par les colons classait comme nuisibles les babouins, les zèbres, les potamochères et les hyènes : ce classement arbitraire sans support scientifique donnait l’autorisation de les tirer à vue.
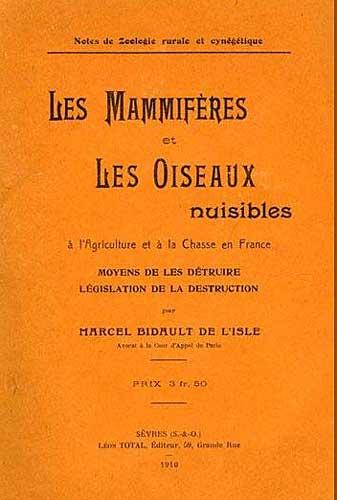
On croyait cette époque révolue 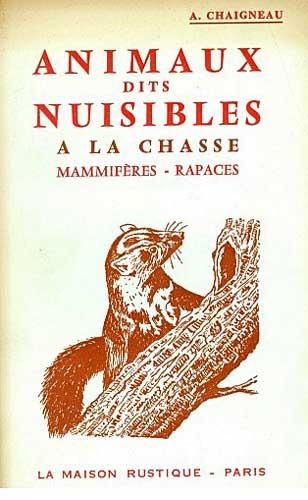
On se contente de transformer l’étiquette de nuisibles en ESOD ; ça change tout
Là encore, cette pratique perdure largement chez nous avec les ESOD, nouveau sigle signifiant Espèces susceptibles d’Occasionner des Dégâts, une catégorie qui remplace l’ancien terme de « nuisibles » devenu infréquentable. On les définit comme « des animaux qui, lorsqu’ils sont trop nombreux, causent des dommages aux activités humaines ainsi qu’un déséquilibre au sein de la faune sauvage (sic) » et dont la destruction est donc légale et encouragée. Outre des espèces invasives introduites posant de réels problèmes écologiques, figurent des espèces autochtones comme la martre, le renard, la pie bavarde, le geai des chênes, la corneille noire dont la destruction peut être autorisée par simple arrête préfectoral départemental. Or, l’introduction de ces espèces dans cette liste repose sur la seule pression des chasseurs qui se plaignent de leur prédation sur les gibiers d’élevage relâchés dans la nature. L’exemple du renard (mais tout autant la martre et les autres) est édifiant quand on connaît son régime alimentaire qui se compose majoritairement de rongeurs ravageurs des cultures et prairies ; aucune étude locale ne démontre qu’il serait responsable du déclin de populations d’espèces sauvages (autre motif fallacieux introduit pour justifier la destruction). Ainsi, une simple étiquette d’ESOD (on ne pouvait pas trouver plus technocratique et cynique comme appellation) permet de justifier la destruction massive organisée d’une espèce pour simplement « plaire à la petite partie de la population du pays qui chasse.

Bibliographie
What’s in a Name?—Consequences of Naming Non-Human Animals Sune BorkfeltAnimals 2011, 1, 116-125
An Antillean plant of beauty, a French botanist, and a German name: naming plants in the Early Modern Atlantic world Laura Hollsten Estonian Journal of Ecology, 2012, 61, 1, 37-50
The orang utan is not an indigenous name: knowing and naming the maias as a decolonizing epistemology June Rubis CULTURAL STUDIES 2020











